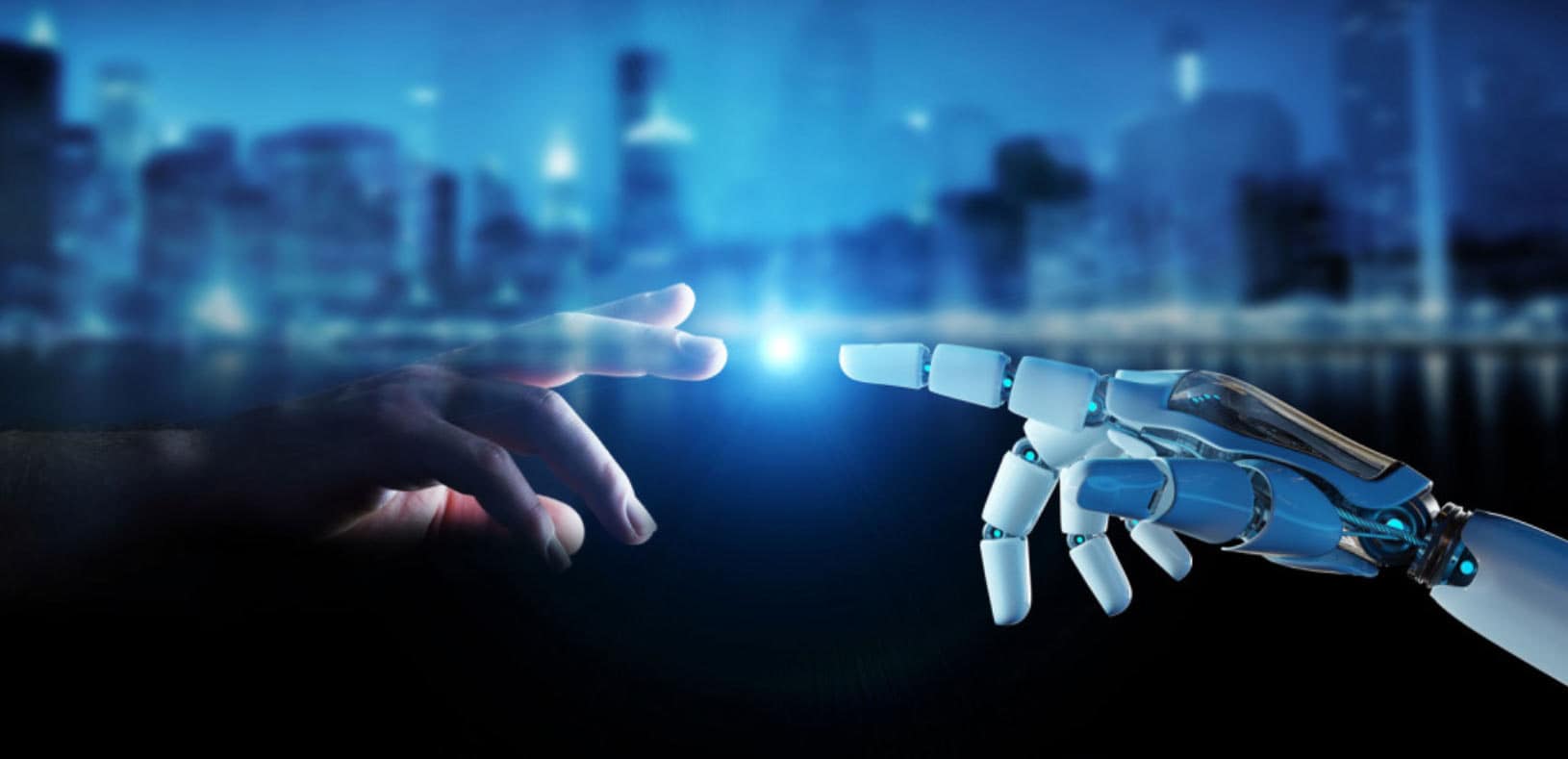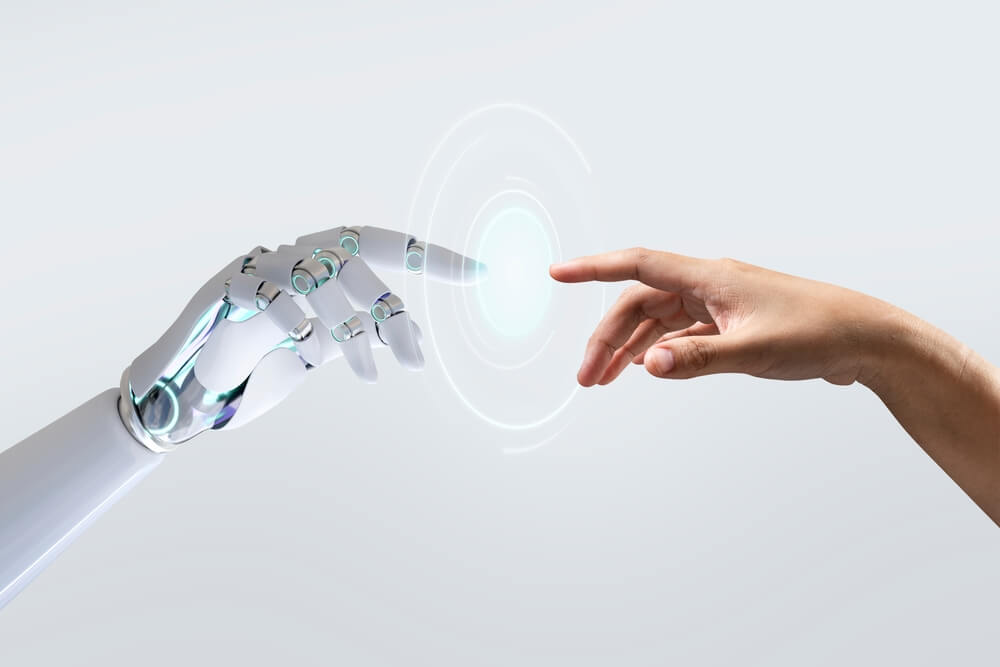La digitalisation de la formation n’est plus un projet annexe ou « nice-to-have » : elle est devenue un véritable levier de compétitivité pour les entreprises. Dans un contexte de transformations rapides (essor de l’IA, nouveaux métiers, généralisation du travail hybride), les organisations qui alignent développement des compétences, expérience collaborateur et priorités business obtiennent de bien meilleurs résultats et s’adaptent plus vite. Une étude McKinsey a ainsi montré que les entreprises championnes du digital et de l’IA surperforment leurs concurrents de 2 à 6 fois en termes de création de valeur pour les actionnaires. En France, la transition est déjà amorcée : 81 % des organismes de formation déclarent avoir entamé une démarche de digitalisation de leur offre. Cependant, réussir à grande échelle implique de relever plusieurs défis : conduite du changement, gouvernance des outils, engagement des apprenants, mesure de l’impact, etc.
Comment alors réussir la digitalisation de la formation dans votre organisation ? Dans cet article, nous proposons un guide pratique pour les responsables RH et L&D de moyennes et grandes entreprises. Nous aborderons les bénéfices d’une formation digitalisée, les piliers d’une transition réussie (allant de l’intégration de l’apprentissage dans le flux de travail à l’exploitation responsable de l’IA), une feuille de route sur 90 jours pour passer à l’échelle, ainsi que les erreurs à éviter. Des données récentes issues de sources fiables (Harvard Business Review, Gartner, McKinsey, LinkedIn Learning…) viendront éclairer nos propos, de même que des exemples concrets inspirés de cas réels. L’objectif : vous fournir des repères clairs, non promotionnels, pour faire de la digitalisation de vos programmes de formation un succès durable en 2025.
Pourquoi la digitalisation de la formation est désormais incontournable ?
Passer à la formation digitalisée, c’est d’abord répondre à une nécessité stratégique. Les compétences évoluent vite et deviennent un avantage concurrentiel décisif. Former plus rapidement, à grande échelle, sans sacrifier l’humain permet d’accompagner les transformations de l’entreprise. D’après Gartner, 77 % des PDG considèrent que l’IA marque le début d’une nouvelle ère pour les entreprises, mais ils estiment que leurs équipes manquent de maturité sur le sujet – seuls 44 % des DSI seraient jugés « aguerris en IA » par leur PDG. Ce décalage souligne l’urgence de renforcer les compétences numériques et d’acculturer l’ensemble des collaborateurs, bien au-delà des seuls experts techniques.
Par ailleurs, la digitalisation de la formation s’impose pour gagner en agilité et en réactivité. Les formats en ligne offrent une flexibilité et une adaptabilité inégalées : accès aux ressources “n’importe où, n’importe quand”, micro-learning, classes virtuelles, e-learning mobile, etc., ce qui s’avère crucial pour toucher des équipes dispersées ou en mode hybride. Cette accessibilité accrue améliore aussi l’équité (on peut former autant les salariés en siège qu’en usine ou en agence régionale). Sur le plan de la scalabilité, le digital permet de standardiser des parcours pour de larges populations tout en les personnalisant grâce aux données et à l’IA (par exemple via des recommandations de contenu ou des parcours adaptatifs selon le niveau).
La formation digitale répond en outre aux nouvelles attentes en matière d’expérience employé. Les collaborateurs d’aujourd’hui aspirent à un développement continu, intégré à leur travail au quotidien. On parle ainsi de learning in the flow of work – en français, apprentissage dans le flux du travail. Concrètement, il s’agit d’apprendre au moment du besoin, directement sur la tâche, au plus près des situations réelles, plutôt que de sortir du poste pour se former en salle. Ce paradigme, popularisé par des experts comme Bob Mosher (avec le modèle des « 5 moments du besoin »), est en plein essor. Il maximise le transfert des acquis et l’impact opérationnel de la formation, tout en répondant au manque de temps disponible. Des ressources intégrées (tutoriels contextuels, guides pas-à-pas, micro-modules, coaching sur le terrain, etc.) permettent ainsi aux collaborateurs de monter en compétence sans interrompre leur flux de travail. (Sur ce sujet, le podcast Speexx Exchange a consacré un épisode aux bonnes pratiques pour intégrer la formation dans le flux de travail d’une organisation.)
Enfin, la digitalisation offre la possibilité de piloter finement l’impact des initiatives L&D. Les plateformes modernes mettent à disposition des tableaux de bord complets pour suivre l’adoption, les taux de complétion, le temps pour acquérir une compétence, etc., en les rapprochant d’indicateurs business (ventes, qualité, satisfaction client, sécurité…). Grâce à la collecte de données, les responsables formation peuvent enfin objectiver le ROI de leurs programmes – à condition toutefois d’anticiper cette mesure. La Harvard Business Review rappelle qu’historiquement, les programmes L&D souffraient d’un ROI difficile à prouver lorsque la métrique est réfléchie trop tard. D’où l’importance de définir dès le départ des indicateurs de succès pertinents et un cadre d’évaluation robuste (nous y reviendrons).
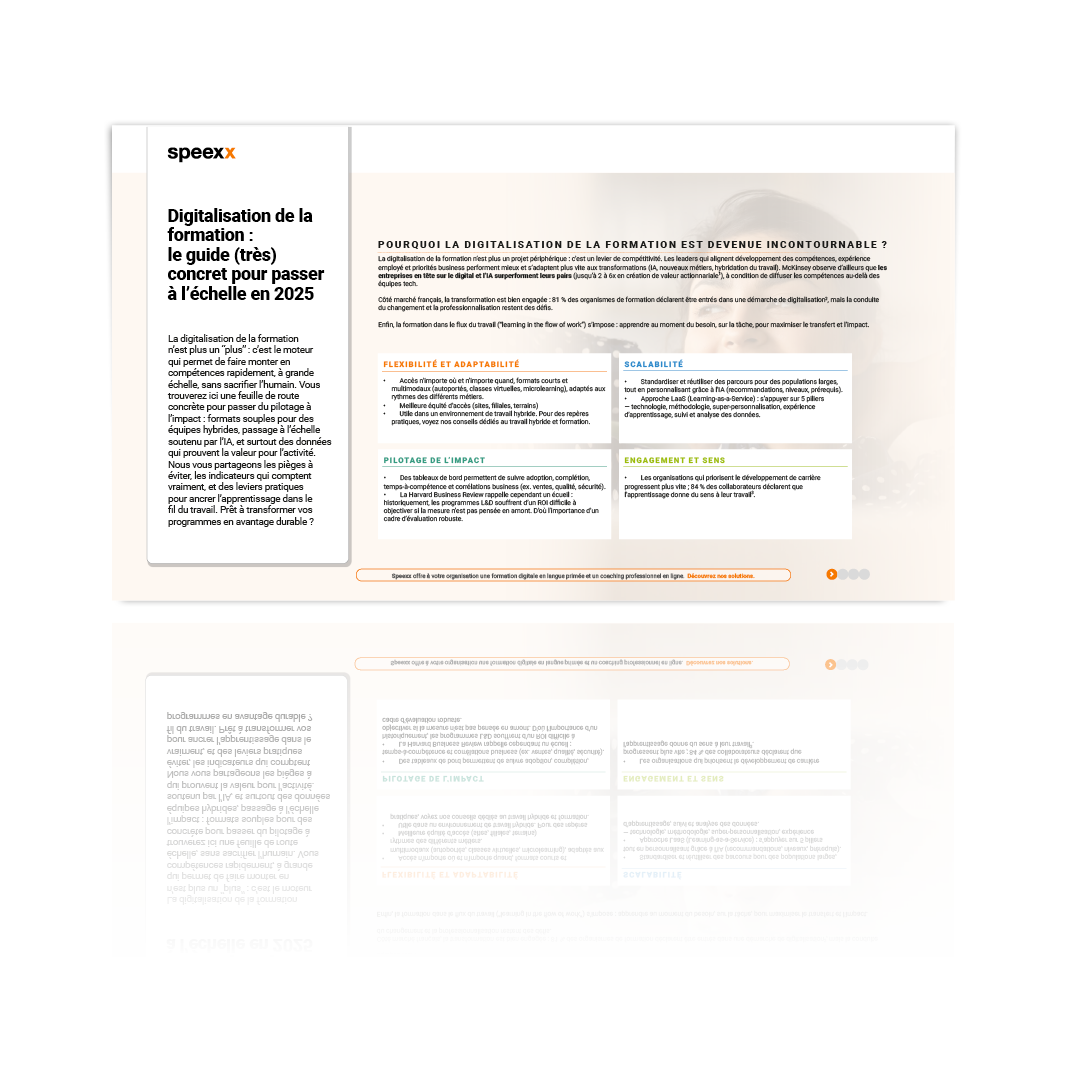
En savoir plus avec notre infographie
Des bénéfices tangibles pour l’entreprise et les apprenants
Une formation digitalisée bien pensée apporte des bénéfices mesurables. Du point de vue de l’entreprise, on peut en attendre : une amélioration de la performance (hausse de la productivité, de la qualité, réduction des erreurs et accidents, meilleur délai d’adaptation aux nouveaux postes), une meilleure rétention des talents et mobilité interne (les organisations championnes du développement voient la mobilité interne boostée, signe que les collaborateurs évoluent en interne plutôt que de partir), ou encore des économies (coûts de formation optimisés, moins de dépenses liées à des erreurs ou à l’assistance) . Côté collaborateurs, le digital learning bien déployé contribue à une meilleure expérience apprenant : les taux de satisfaction et d’engagement en formation augmentent, de même que le taux d’achèvement des parcours et la rétention des connaissances. Surtout, l’apprentissage en continu redonne du sens au travail : 84 % des collaborateurs estiment que se former régulièrement donne un sens supplémentaire à leur mission. Cette quête de sens et de développement est un moteur de motivation et de fidélisation puissant – un argument de plus pour investir dans la digitalisation de la formation.
Les piliers d’une digitalisation de la formation réussie : alliance de l’humain et de la technologie
Comment concrètement passer du pilote à l’impact, c’est-à-dire dépasser l’expérimentation pour intégrer la formation digitale à grande échelle dans l’entreprise ? Plusieurs facteurs clés de succès émergent des retours d’expérience. Ils reposent sur un équilibre entre innovations technologiques et ancrage humain. Voici les principaux piliers d’une transition réussie, que nous allons détailler :
- Aligner la formation sur la stratégie et les compétences critiques
- Ancrer l’apprentissage dans le flux de travail
- Allier digital et humain dans les parcours
- Exploiter l’IA avec discernement
- Bâtir une architecture data et analytics pour mesurer l’impact
- Conduire le changement et marketer la formation
Aligner la formation sur les priorités stratégiques et compétences critiques
Toute transformation réussie commence par le sens et la stratégie. Il s’agit de partir des objectifs business de l’entreprise et des compétences métiers critiques pour y parvenir. En pratique, cela signifie cartographier les compétences à fort enjeu (pour aujourd’hui et à 1-2 ans) et identifier les écarts à combler parmi les collaborateurs. Cette approche « skills first » est recommandée par McKinsey pour favoriser la mobilité interne et la résilience des organisations. En alignant dirigeants, RH et L&D autour de ces priorités, on garantit que la digitalisation de la formation répond à un véritable besoin métier (et non à un simple effet de mode technologique). Par exemple, si l’entreprise vise une expansion internationale, les compétences linguistiques seront prioritaires ; si l’orientation est à l’hyper-automatisation, les compétences en data et IA deviendront centrales, etc. Connaître ses besoins permet de concentrer les efforts de digital learning là où ils auront le plus d’impact, et de définir des objectifs mesurables (accélérer le temps pour maîtriser telle compétence, former X collaborateurs d’ici 6 mois sur tel outil, etc.).
Intégrer la formation dans le flux de travail au quotidien
Comme évoqué, l’apprentissage intégré au travail (learning in the flow) est l’une des tendances de fond du digital learning. Pour ancrer véritablement la formation dans la culture de l’entreprise, il faut faciliter son intégration dans le quotidien des équipes. En pratique, cela implique de prévoir des ressources et moments de formation au moment du besoin. Par exemple : mettre à disposition des guides pratiques ou capsules e-learning directement dans les outils de travail (intranet, MS Teams, applications métier) pour aider un employé sur une tâche précise ; proposer des simulations ou études de cas courtes à réaliser entre deux missions ; ou encore organiser de brefs coachings « on the job » où un formateur passe du temps sur le terrain avec l’équipe. L’objectif est de minimiser l’interruption du travail : l’apprenant se forme en situation réelle, ce qui maximise le transfert et l’efficacité.
Cette approche nécessite également d’aménager le temps de formation dans l’activité. Un piège courant est de penser qu’avec le digital, les collaborateurs trouveront bien un moment pour se former quand ils voudront. En réalité, sans encouragement ni organisation, les modules en ligne risquent de s’empiler sans être suivis. Il est donc crucial de prévoir des micro‐moments dédiés : par exemple des modules courts de 5 à 10 minutes insérés dans la journée, ou des rituels comme le « quart d’heure compétence » en début de semaine, soutenus par les managers . En intégrant ces routines, on crée une habitude d’apprentissage continue plutôt qu’exceptionnelle. (Pour plus de conseils sur ce sujet, voir l’article Speexx « Engagement apprenant : les clés pour une formation efficace et durable », qui insiste notamment sur l’importance d’une application immédiate des acquis dans le travail.)
Allier le digital et l’humain pour un parcours complet
Digitaliser ne signifie pas déhumaniser. Au contraire, les programmes de formation les plus efficaces combinent le meilleur des deux mondes : des outils digitaux performants et des interactions humaines riches. D’un côté, l’auto-formation en ligne apporte flexibilité, individualisation et coût marginal réduit. De l’autre, le coaching, le tutorat ou les ateliers animés par un formateur apportent du contexte, du feedback personnalisé, le partage d’expériences et maintiennent la motivation.
Il est prouvé que l’élément humain renforce l’engagement des apprenants. Un dispositif 100% en ligne, sans aucune intervention humaine, peut rendre l’apprentissage plus froid et impersonnel, au risque de voir la participation chuter sur la durée. À l’inverse, intégrer des sessions avec un formateur ou un coach (physiques ou virtuelles) à intervalles réguliers permet de soutenir les apprenants, de répondre à leurs questions et de lever les blocages. Par exemple, Speexx intègre dans ses parcours de langues en ligne des sessions de coaching en visioconférence avec des tuteurs natifs : cette alliance de la plateforme digitale et du coaching humain maximise les progrès, en gardant la dimension relationnelle essentielle (encouragement, empathie, correction personnalisée). De même, encourager les échanges entre pairs via des forums, chats ou ateliers collaboratifs ajoute une dimension sociale stimulante à la formation.
Le rôle de l’humain est également crucial pour ce qu’on appelle les « soft skills » ou compétences comportementales (leadership, créativité, empathie, collaboration…). Ces compétences, de plus en plus prisées, se développent par la pratique et le feedback humain. Digitaliser la formation doit donc aussi rimer avec « humaniser la plateforme » en y intégrant des animations, des communautés apprenantes, et en outillant les formateurs et managers pour accompagner les collaborateurs tout au long de leur parcours.
Exploiter l’IA… avec discernement
L’intelligence artificielle s’impose progressivement dans le domaine de la formation : algorithmes de recommandation de contenus, chatbots tuteurs, analyses prédictives des besoins, génération automatique de quiz, etc. Côté professionnels L&D, la majorité a commencé à explorer ces opportunités. LinkedIn rapporte que 71 % des responsables formation expérimentent ou intègrent déjà l’IA dans leur travail quotidien. Les avantages sont multiples : personnalisation accrue des parcours, automatisation de tâches fastidieuses (par exemple, corriger des exercices ou compiler des rapports), analyse fine des données d’apprentissage pour améliorer en continu les contenus.
Cependant, il convient d’aborder l’IA avec discernement. D’une part, son déploiement soulève des questions de qualité pédagogique (une IA ne remplacera pas complètement un expert humain pour certains feedbacks nuancés), de biais éventuels dans les contenus générés, ou encore de confidentialité des données (attention aux outils externes qui traitent des données sensibles de l’entreprise ou des apprenants). D’autre part, l’adhésion des équipes ne va pas de soi : même si plus des deux tiers des collaborateurs utilisent déjà des outils d’IA générative dans leur travail, 42 % d’entre eux estiment manquer de soutien formel de la part de leur organisation pour encadrer ces usages. Les freins à l’adoption de l’IA dans la formation résident aussi dans le manque de temps et de support managérial pour tester ces innovations.
Les priorités pour 2025 seront donc d’accélérer la montée en compétences sur l’IA (former les employés et les leaders aux fondamentaux de l’IA, aux outils émergents comme ChatGPT, etc.) et de sécuriser les usages. Cela passe par l’élaboration de règles claires (chartes éthiques sur l’IA, politiques d’usage des données), par la sensibilisation des managers, et par l’accompagnement des apprenants dans l’utilisation de ces nouveaux outils. In fine, l’IA doit être vue comme un levier pour amplifier l’apprentissage, pas comme une baguette magique. Un exemple concret : certaines entreprises ont implémenté des « assistants IA » couplés au LMS, capables de répondre aux questions fréquentes des apprenants ou de générer des résumés de cours. Mais elles encouragent aussi les apprenants à valider ces informations avec un formateur, surtout pour les sujets critiques. Il s’agit d’exploiter l’IA comme un assistant pour aller plus vite et plus loin, tout en gardant un esprit critique humain. (Pour aller plus loin, lire l’article Speexx « Génération IA : de nouvelles compétences pour une nouvelle ère », qui explore comment l’IA redéfinit les compétences attendues et comment les employeurs peuvent en tirer parti.)
S’appuyer sur les données pour piloter l’impact métier de la formation
Un écueil classique des projets de formation est de ne pas mesurer suffisamment tôt ni suffisamment bien les résultats obtenus. Pour réussir la digitalisation de la formation, il est indispensable de bâtir dès le départ une architecture data & analytics solide côté L&D. Concrètement, cela signifie définir deux types de métriques : les outputs et les outcomes. Les métriques d’output correspondent aux indicateurs d’usage et de qualité pédagogique : par exemple le taux d’inscription et de complétion des modules, le temps moyen pour terminer un parcours, le score de satisfaction des apprenants, le NPS de la formation, etc. Les métriques d’outcome s’intéressent, elles, à l’effet sur le business : gain de productivité, amélioration du taux de conversion commerciale, baisse du taux d’incident ou d’erreur, réduction du turnover, etc..
Il faut définir dès la conception du programme quels indicateurs seront suivis, comment ils seront collectés et quelles cibles on vise. Par exemple, pour un programme de formation des managers, on peut décider de suivre le score d’engagement des équipes managées (via une enquête interne) avant et 6 mois après la formation, ou encore le taux de mobilité interne des participants sur l’année suivant le programme. Ce cadre de mesure permettra de prouver la valeur de la formation auprès des parties prenantes, et d’ajuster en cours de route si certains objectifs ne sont pas atteints. Une erreur courante est de vouloir évaluer a posteriori, sans base de référence : on se retrouve alors avec un ROI difficile à calculer, faute de données comparatives. Penser l’évaluation en amont est donc un principe d’or.
Heureusement, des référentiels existent pour guider cette démarche. La Harvard Business Review et LinkedIn Learning ont publié des cadres et playbooks pour mesurer le ROI des formations. Par exemple, LinkedIn recommande d’identifier quelques « métriques qui comptent » alignées sur les priorités de l’entreprise, puis de raconter une histoire reliant le développement des collaborateurs à des résultats concrets (ventes, satisfaction client, etc.). On peut citer le cas d’AXA qui a suivi le lien entre le déploiement d’un programme digital de formation aux ventes et l’évolution des chiffres d’affaires par conseiller : en croisant les données LMS et CRM, ils ont pu montrer que les conseillers ayant complété le parcours dépassaient leurs objectifs commerciaux de X%, tandis que les non-participants restaient en deçà. Ce type d’insight aligne la formation sur le langage du business, ce qui est essentiel pour convaincre direction générale et managers d’investir dans le digital learning.
En interne, il est également crucial de développer la capacité d’analyse L&D. Cela peut passer par la montée en compétence de l’équipe formation sur les outils analytics (tableaux de bord, data visualisation, etc.), ou le recrutement de profils spécialisés (par exemple un Learning Analyst). Certaines grandes entreprises créent même des squads pluridisciplinaires réunissant L&D, Data et RH pour exploiter les données de formation de manière avancée. L’ambition : passer d’un suivi essentiellement quantitatif (taux de connexion, nombre d’heures de formation) à un suivi qualitatif et prédictif (impact sur la performance, anticipation des besoins futurs via l’analyse de compétences manquantes, etc.).
Conduire le changement et « marketer » la formation digitale
Dernier pilier, et non des moindres : la réussite d’un projet de digitalisation repose sur une bonne conduite du changement. Adopter une nouvelle plateforme LMS, de nouveaux formats en ligne, une nouvelle approche pédagogique… cela représente un changement culturel pour l’organisation. Or, selon le baromètre du FFFOD, la professionnalisation de ces pratiques de changement reste un défi majeur pour les organismes de formation en France. Beaucoup ont sous-estimé l’accompagnement nécessaire, d’où parfois des taux d’adoption décevants.
Il convient donc de penser son plan de conduite du changement dès le départ. Cela passe par plusieurs axes :
- Leviers managériaux : impliquer les managers de proximité, car ce sont eux qui encourageront (ou décourageront) concrètement leurs équipes à utiliser les nouveaux dispositifs. Il faut les informer, éventuellement les former eux-mêmes, et en faire des relais positifs de la formation digitale. Par exemple, un manager convaincu pourra intégrer dans ses points hebdo un tour de table sur ce qui a été appris de nouveau, valorisant ainsi l’effort de formation de ses collaborateurs.
- Communication interne : il faut déployer un véritable marketing de la formation en interne. Autrement dit, ne pas se contenter d’un email de lancement du type « voici la nouvelle plateforme, connectez-vous », mais mener une campagne de communication soutenue dans le temps. On peut utiliser des teasers, des témoignages de collaborateurs pilotes, des infographies (telle que celle de Speexx utilisée pour cet article), des tutoriels vidéo, etc., pour donner envie et expliquer concrètement les bénéfices des nouveaux outils. Le maître-mot est de montrer que la formation digitale est là pour servir le collaborateur (l’aider à progresser et à gagner du temps), pas pour le contrôler. (Sur ce point, voir notre article « Le marketing de la formation : une compétence encore peu maîtrisée» qui fournit des conseils pour rendre vos offres de formation visibles et attractives en interne.)
- Gouvernance et support : ne lancez pas une nouvelle technologie sans une gouvernance claire. Qui décide des contenus à intégrer sur le LMS ? Quelles sont les règles d’utilisation des données (surtout avec l’IA et la RGPD) ? Quel support est offert aux utilisateurs en cas de question ou problème technique ? Il est recommandé de rédiger une charte concise expliquant la finalité de la plateforme, les engagements en matière de confidentialité et d’éthique (par ex., comment seront – ou ne seront pas – utilisées les données d’apprentissage, règles d’utilisation de l’IA générative, etc.). Cette charte, accompagnée de processus d’assistance clairs, doit être diffusée et expliquée aux managers et apprenants pour instaurer un climat de confiance. En parallèle, prévoyez des formations au changement pour l’équipe formation elle-même si nécessaire, afin qu’elle maîtrise les nouveaux outils et méthodes (on parle de upskilling de la fonction L&D).
En résumé, il faut « marketer » votre projet de formation digitale comme un produit dont il faut réussir le lancement et l’adoption. Un effort initial important sur la communication et l’accompagnement sera gage d’usages durables sur le long terme. A contrario, un déploiement technologique réalisé à la hâte, sans gouvernance ni conduite du changement, a de grandes chances de faire flop (beaucoup d’entreprises en ont fait l’expérience avec des LMS non utilisés, ou des MOOC mis à disposition sans participants).
Feuille de route : 90 jours pour démarrer et passer à l’échelle
Pour concrétiser ces principes, il est utile de se fixer un plan d’action sur les 90 premiers jours du projet. Voici une feuille de route synthétique, inspirée des retours terrain, pour lancer la digitalisation de la formation et commencer à en mesurer l’impact en trois mois.
J 0 à J 30 : Cadrez et priorisez.
Cette première phase consiste à poser les bases solides du projet. Définissez d’abord 2 ou 3 objectifs principaux, mesurables, qui seront votre boussole (ex : réduire de 30 % le délai d’intégration des nouveaux embauchés grâce à un parcours digital onboarding). En parallèle, réalisez une cartographie des besoins : quelles sont les missions clés à cibler en priorité, quels niveaux de compétences visés, quels écarts par rapport à l’existant ? Cela permet de choisir où concentrer les efforts pilotes. Sur cette base, commencez à créer ou adapter quelques parcours de formation digitaux. L’intégration au flux de travail doit être pensée dès la conception : assurez-vous que les modules soient facilement accessibles dans l’environnement de travail, compatibles mobile, avec des durées adaptées. Prévoyez également les questions de conformité (RGPD pour les données apprenants, accessibilité si besoin, etc.). Enfin, établissez les indicateurs de succès dès le départ (par exemple, viser 80 % d’appropriation sur la population pilote, et un impact de +10 % sur un KPI métier défini) ainsi que le point de référence initial (mesurez la situation de départ sur vos indicateurs).
Phase pilote (J 0 à J 60) : Tester, instrumenter, ajuster.
Plutôt que de déployer d’emblée à toute l’entreprise, il est conseillé de lancer quelques parcours pilotes sur un échantillon (par exemple, une ou deux équipes volontaires, sur une durée de 6 à 8 semaines). Choisissez des situations professionnelles réelles pour ces parcours afin d’observer l’impact concret. Pendant cette phase, mettez en place une instrumentation rigoureuse : tableaux de bord de suivi de la participation, questionnaires « à chaud » (juste après la formation) et « à froid » (quelques semaines après, pour mesurer l’ancrage), et collecte de premières données en lien avec les objectifs stratégiques fixés. Par exemple, si l’objectif était d’améliorer la qualité, mesurez le taux de défauts avant/après chez l’équipe pilote formée. Organisez des points réguliers avec les managers des équipes pilotes pour recueillir leur ressenti, détecter d’éventuels freins (techniques, organisationnels) et apporter des ajustements rapides aux contenus ou à l’organisation si nécessaire. Cette boucle de feedback agile permet de corriger le tir avant de passer à l’échelle.
J 31 à J 60 : Évaluer le ROI et préparer le déploiement.
À l’issue de la phase pilote, il est temps de faire un premier bilan. Analysez les taux d’appropriation, les taux d’achèvement des modules, le temps moyen pour atteindre la maîtrise visée, la satisfaction des participants, etc., et comparez-les aux objectifs. Surtout, évaluez les indicateurs d’impact métier : observez les écarts avant/après sur les métriques opérationnelles ciblées (par ex., +15 % de productivité, –20 % d’accidents, etc.). Même si l’échantillon est réduit, ces chiffres pilotes vous serviront à bâtir le business case interne. Parallèlement, préparez un guide de déploiement plus large, capitalisant sur les leçons du pilote : élaborez des check-lists, précisez les rôles et responsabilités (qui fait quoi entre l’équipe formation, les managers, les experts métiers impliqués), et rassemblez les supports de communication et d’accompagnement nécessaires. L’objectif est d’avoir une “boîte à outils” prête pour reproduire ce qui marche à plus grande échelle.
J 61 à J 90 : Montée en puissance.
Vous pouvez désormais étendre ce qui fonctionne à un périmètre plus large. Par exemple, si le pilote concernait 50 personnes dans un service, étendez au département entier, voire à d’autres sites. Enrichissez le catalogue de formations digitalisées en vous appuyant sur les contenus qui ont fait leurs preuves, et utilisez les fonctionnalités d’IA de la plateforme pour recommander ces parcours aux bonnes personnes (en fonction de leur poste, niveau, compétences cibles). Prévoyez également d’accompagner la montée en échelle avec du tutorat : par exemple, former quelques “ambassadeurs” ou référents dans chaque entité, chargés d’aider leurs collègues à tirer parti des nouveaux modules (systèmes de mentors internes, forums de discussion animés, etc.). Continuez bien sûr le suivi des KPI et la collecte de feedback pour alimenter un cycle d’amélioration continue. En 90 jours, vous aurez ainsi établi une base solide et prouvé la valeur du concept, ce qui vous donnera la crédibilité et les enseignements nécessaires pour poursuivre la transformation à plus long terme.
(Nota : La feuille de route ci-dessus est indicative et devra être adaptée à la taille et la structure de chaque organisation. L’essentiel est de combiner une vision stratégique claire avec une approche itérative – tester, mesurer, améliorer – afin de sécuriser les résultats.)
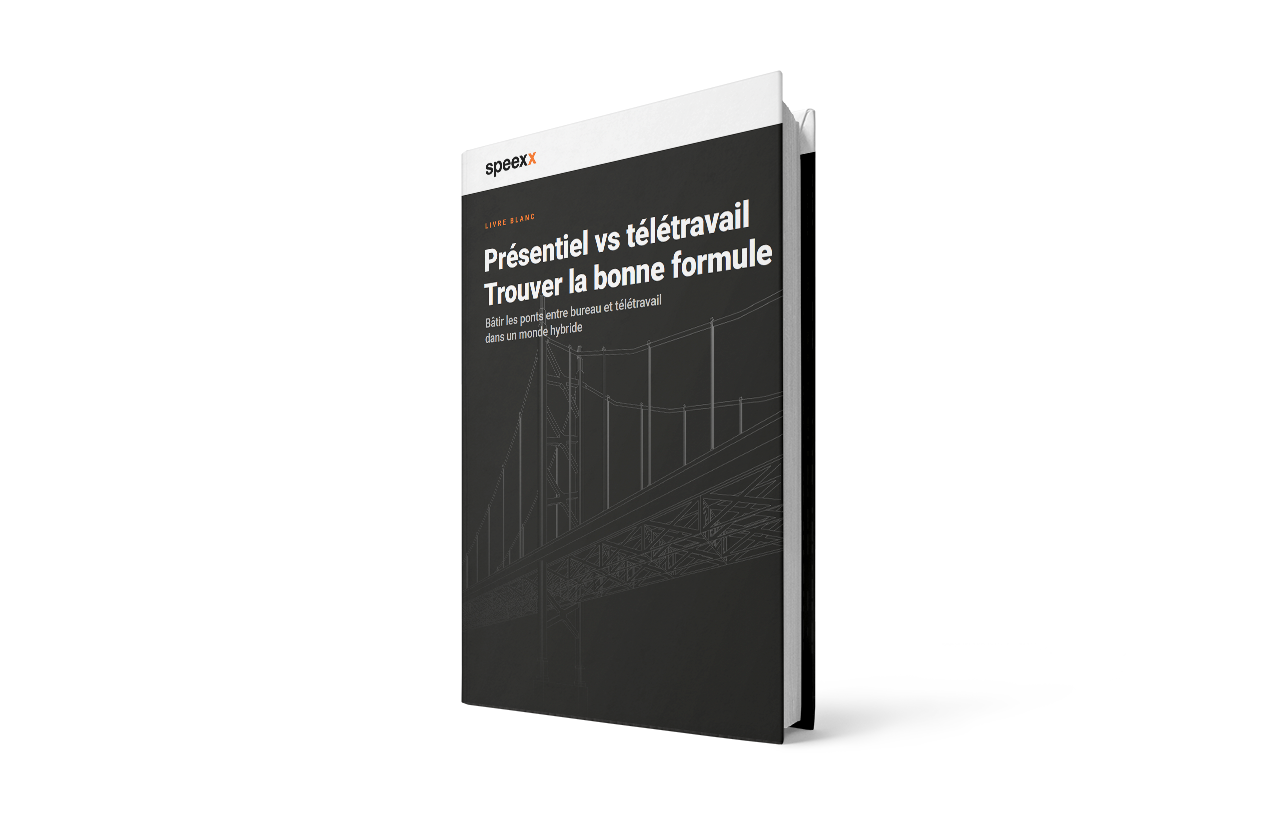
Téléchargez le livre blanc
Les erreurs courantes à éviter dans un projet de formation digitalisée
Pour finir, il est utile de connaître les principaux pièges relevés lors de projets de digitalisation de la formation, afin de les éviter dans votre propre déploiement. En voici quatre parmi les plus fréquents :
- Lancer une nouvelle technologie sans gouvernance ni cadre. Enthousiasmée par un outil de digital learning à la mode, une entreprise peut être tentée de le déployer rapidement… sans avoir défini de gouvernance. C’est un risque majeur : qui va administrer la plateforme, la maintenir, décider des contenus à y intégrer ? Quelles règles pour l’usage des données ou de l’IA embarquée ? Sans réponses claires, on court à la confusion, voire à des usages inappropriés. Ne déployez pas d’outil sans gouvernance: nommez un responsable projet, définissez des règles d’usage (charte sur la sécurité, la confidentialité, l’éthique), et mettez en place des processus (comité de pilotage, points d’arbitrage, circuit pour remonter les bugs). Puis, communiquez ces règles aux utilisateurs. Un lancement réussi repose autant sur la techno que sur la gouvernance humaine
- Penser à mesurer le succès trop tard. Comme nous l’avons souligné, attendre la fin du projet pour se préoccuper des indicateurs est une erreur. Si vous n’avez pas défini en amont comment vous mesurerez l’impact de la formation, vous risquez de ne pas pouvoir prouver la valeur créée, ni d’identifier ce qui doit être ajusté. Par exemple, si après un an de digitalisation on vous demande “quel est le ROI ?”, et que vous n’avez pas collecté de données tangibles, le projet pourrait être remis en question. Fixez dès la conception les indicateurs d’appropriation et d’impact à suivre, ainsi que les méthodes de comparaison (groupe témoin, période avant/après, etc.) . C’est un travail supplémentaire au départ, mais indispensable pour piloter par la preuve et sécuriser l’adhésion de la direction.
- Tout miser sur le digital en oubliant le facteur humain. La technologie ne fait pas tout. Un dispositif 100 % en e-learning, sans aucune intervention humaine, aura du mal à engager sur la durée et à ancrer les apprentissages. Il est crucial de prévoir des interactions humaines dans votre modèle digital. Par exemple, planifiez des sessions de coaching ou de tutorat en complément des modules en ligne, encouragez les échanges entre pairs (forums, groupes dédiés), proposez des cas pratiques avec retours personnalisés. Le digital doit être vu comme un amplificateur, pas un substitut complet à l’humain. N’oubliez pas que se former est un acte profondément humain, qui engage la motivation, le partage, l’émotion – des dimensions qu’aucune machine ne reproduira totalement.
- Négliger la contrainte temps : “ils se formeront bien quand ils voudront !”. Enfin, beaucoup de projets échouent parce qu’on a sous-estimé la charge de travail des apprenants. Certes, le digital permet de se former “n’importe où, n’importe quand”. Pour autant, les collaborateurs n’ont pas spontanément du temps libre au milieu de leurs journées chargées. Ne pas planifier le temps de formation revient souvent à voir les modules en ligne rester lettre morte, faute de disponibilité. La solution : concevoir des formats suffisamment brefs et ciblés (just in time, just enough), intégrés aux routines de travail. Comme mentionné plus haut, pensez micro-learning (quelques minutes) et libérez des micro-moments dédiés pendant le temps de travail. Impliquez les managers pour qu’ils accordent à leurs équipes ce temps régulier de développement. Une entreprise qui a réussi sa transformation digitale de la formation est souvent celle qui a su créer une habitude collective autour du learning, par petites touches mais fréquentes.
En évitant ces écueils et en appliquant les bonnes pratiques détaillées dans cet article, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour réussir la digitalisation de la formation au sein de votre organisation. Pour résumer, il s’agit de placer l’humain au centre (compétences, engagement, accompagnement) tout en tirant parti des formidables leviers technologiques du moment (plateformes, IA, data). La formation n’est plus un centre de coût dont on espère vaguement des retombées ; c’est un investissement stratégique qui, s’il est bien piloté, apporte un avantage concurrentiel durable. D’ailleurs, selon LinkedIn Learning, plus de 84 % des collaborateurs estiment que l’apprentissage en continu leur donne du sens et les motive dans leur travail , et les entreprises dotées d’une forte culture d’apprentissage affichent des taux de rétention du personnel et de mobilité interne bien supérieurs aux autres.

En 2025, réussir la digitalisation de la formation, c’est réussir à la fois la montée en compétences de ses talents et la transformation de son organisation. C’est un défi passionnant qui requiert une vision, de la méthode et une bonne dose de leadership. À vous de jouer – et n’oubliez pas que vous n’êtes pas seuls dans cette aventure : de nombreuses ressources (livres blancs, études de cas, communautés de pratique) et partenaires experts comme Speexx peuvent vous accompagner tout au long du chemin (sans jamais faire le travail à votre place, bien sûr). Bonne digitalisation !