La formation professionnelle est un levier stratégique pour les entreprises, mais son financement reste souvent un labyrinthe de dispositifs, d’acteurs et d’acronymes. En France, le paysage de la formation continue a été profondément remanié ces dernières années, notamment avec l’instauration du Compte Personnel de Formation (CPF). Si chaque individu dispose d’un compte formation alimenté en euros, les entreprises demeurent au cœur du financement et de l’organisation des formations de leurs salariés. Cet article approfondit les mécanismes de financement de la formation par et pour les entreprises dans un cadre global. Nous verrons comment les entreprises contribuent à la montée en compétences de leurs collaborateurs, quelles obligations et aides existent, et quelles stratégies permettent d’optimiser le budget formation, quelle que soit la taille de l’organisation.
Obligations légales et contributions des entreprises
En France, les entreprises ont l’obligation légale de participer au financement de la formation professionnelle de leurs salariés. Cette participation prend la forme de contributions financières mutualisées. La principale contribution est la CUFPA (Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance), qui a remplacé l’ancienne taxe formation. Chaque année, environ 11 milliards d’euros sont collectés via la CUFPA. Ces fonds sont ensuite redistribués par des organismes dédiés (URSSAF en tant que collecteur, France Compétences en tant que répartiteur) vers différents dispositifs de formation.
Une part massive de ces financements est fléchée vers l’alternance (contrats d’apprentissage et de professionnalisation) et vers le CPF. Environ 80 % des sommes disponibles sont consacrées à l’alternance et au CPF, les autres dispositifs étant en léger recul sur les cinq dernières années. Plus précisément, l’alternance capte à elle seule près de 69 % des fonds et le CPF environ 14 %. Ces chiffres illustrent que l’effort financier des entreprises se concentre majoritairement sur la formation en alternance – un mode de formation qui bénéficie à la fois aux apprentis et aux employeurs – et sur les droits CPF des individus.
Outre la CUFPA, les entreprises de plus grande taille doivent s’acquitter de contributions supplémentaires, par exemple la CSA (Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage) pour celles de plus de 250 salariés. Elles doivent également financer un CPF spécifique pour les salariés en CDD (contrat à durée déterminée) via la contribution CPF-CDD. L’ensemble de ces contributions obligatoires constitue un investissement de base des entreprises dans la formation professionnelle à l’échelle nationale.
En contrepartie, surtout pour les petites structures, des dispositifs de financement ou d’aides peuvent être mobilisés (via les OPCO par exemple, les opérateurs de compétences par branche professionnelle). Cependant, pour les organisations de plus de 50 salariés, les aides externes sont plus limitées, ce qui les oblige à financer davantage sur fonds propres et à optimiser l’usage de leur budget formation.
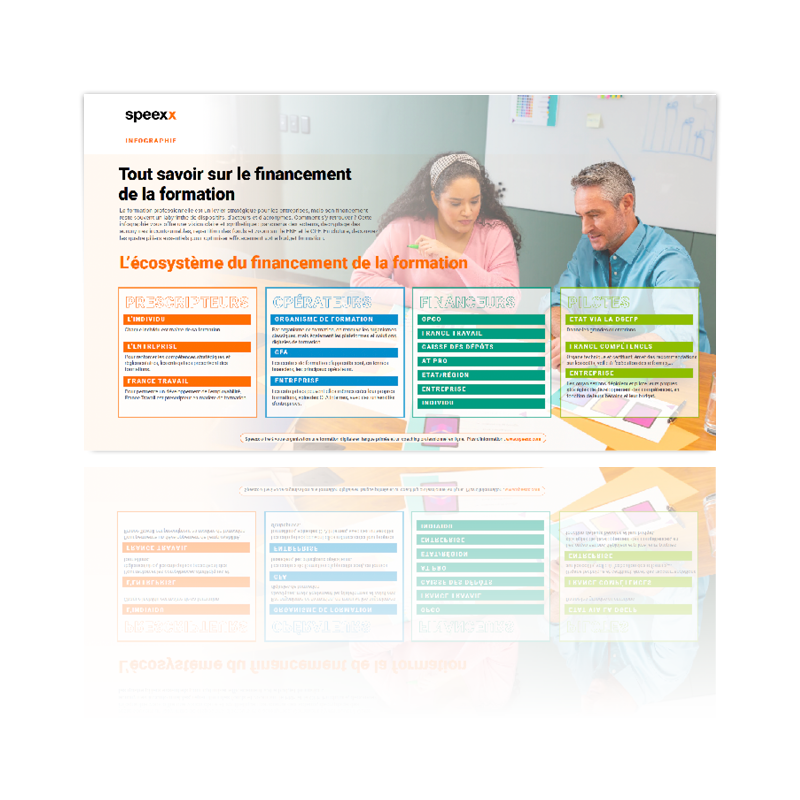
Retrouvez toutes les grandes stratégies dans notre infographie
Le CPF : un compte personnel à co-construire avec l’entreprise
Le Compte Personnel de Formation (CPF), alimenté en euros chaque année pour chaque actif, a introduit une nouvelle donne en donnant à chaque individu la main sur ses droits à la formation. Pour autant, les entreprises jouent un rôle déterminant pour encourager et co-construire l’utilisation du CPF par leurs collaborateurs. En effet, un salarié peut décider de se former de son propre chef via son CPF, mais il est souvent bénéfique que l’employeur s’implique afin d’aligner le choix des formations sur les besoins stratégiques de l’entreprise et de co-financer si nécessaire.
Au fil du temps, on observe que le CPF tend à être “co-construit” entre les collaborateurs et les entreprises plutôt que laissé à l’initiative isolée de chacun. L’entreprise peut endosser un véritable rôle de conseil et de partenaire dans la mobilisation du CPF. D’une simple information des salariés sur leurs droits, on peut aller jusqu’à un véritable accord CPF négocié au sein de l’entreprise, qui cadre les règles d’utilisation du CPF en lien avec la politique de formation interne. Voici, par ordre croissant d’implication, les cinq niveaux de co-construction possibles autour du CPF :
- Sensibiliser les collaborateurs à l’utilisation de leur CPF : la première étape consiste à communiquer et former les salariés sur l’existence du CPF, le mode d’emploi de la plateforme MonCompteFormation et les encourager à l’utiliser. Beaucoup d’employés ignorent encore les formations éligibles ou le solde dont ils disposent. L’entreprise gagne à promouvoir activement cet outil auprès de ses équipes.
- Permettre la formation sur le temps de travail : un levier essentiel est d’autoriser, voire d’encourager, les salariés à réaliser leurs formations CPF durant les heures de travail. Sans cet aménagement, un salarié doit en principe se former sur son temps libre, ce qui peut être dissuasif. En intégrant la formation au temps de travail (via une autorisation d’absence rémunérée pour formation, par exemple), l’entreprise montre qu’elle valorise le développement des compétences.
- Créer un catalogue interne de formations éligibles au CPF : de plus en plus d’organisations élaborent une liste de formations éligibles CPF recommandées. Il s’agit d’un catalogue interne aligné sur les besoins de compétences de l’entreprise. Les salariés y piochent des idées de formations utiles à leur évolution professionnelle et à la stratégie de l’entreprise. Ce catalogue peut résulter de négociations avec des organismes de formation pour obtenir des places ou tarifs groupés sur des formations ciblées. C’est une manière de guider le choix tout en utilisant les fonds du CPF, tout en permettant de se prémunir des arnaques au CPF, qui restent nombreuses.
- Abonder le CPF à la demande : l’entreprise peut décider de co-financer une formation onéreuse en abondant le compte CPF du collaborateur. Ce complément financier, versé directement sur le CPF via la plateforme dédiée, permet de couvrir le reste à charge si le coût dépasse le crédit disponible du salarié. De tels abondements CPF vont devenir de plus en plus indispensables dans le contexte budgétaire actuel, où les financements publics se restreignent et où les entreprises sont incitées à mettre la main à la poche pour former leurs collaborateurs. D’ailleurs, face à la montée en puissance de ces abondements employeurs, un décret du 14 avril 2025 est venu encadrer ces pratiques. Il fixe un plafond au montant versé par l’employeur, définit les conditions d’attribution de la somme, prévoit un remboursement si la formation n’est finalement pas réalisée, peut conditionner l’aide à une formation précise et impose un délai maximal pour s’inscrire. Ces garde-fous visent à assurer le bon usage des fonds co-investis sur le CPF.
- Négocier un accord CPF d’entreprise : le niveau le plus abouti de co-construction est la mise en place d’un accord formalisé (souvent avec les partenaires sociaux) sur le CPF. Un tel accord CPF peut définir, par exemple, une stratégie commune de développement des compétences, les priorités de formation éligibles, le principe d’un abondement systématique par l’entreprise sur certaines actions ou encore l’intégration du CPF dans le plan de développement des compétences. L’accord peut également formaliser le droit à la formation sur temps de travail ou la création du fameux catalogue interne. En négociant un cadre collectif, l’entreprise s’assure d’une utilisation du CPF cohérente avec ses objectifs tout en motivant les salariés à se former.
En franchissant “le cap de la co-construction” sur le CPF, entreprises et salariés trouvent un terrain d’entente gagnant-gagnant : le collaborateur voit son employabilité et son évolution de carrière facilitée, tandis que l’entreprise développe les compétences dont elle a besoin et fidélise ses talents.
Investir dans la formation en interne : l’essor des universités d’entreprise
Au-delà des dispositifs publics et mutualisés, les entreprises prennent aussi directement en charge une part importante de la formation. Chaque employeur bâtit son Plan de Développement des Compétences (PDC) – anciennement appelé plan de formation – qui recense les actions de formation financées sur fonds propres pour ses salariés. Ces formations internes ou externes, décidées par l’entreprise en fonction de ses besoins, constituent un investissement volontaire en plus des contributions obligatoires. De nombreuses entreprises n’hésitent pas à dépasser leurs obligations légales en consacrant un budget conséquent au développement des compétences, convaincues que c’est un levier de performance et d’innovation.
Cette dynamique se manifeste notamment par la création d’universités d’entreprise. Ces structures internes, parfois qualifiées d’“académies” ou d’“instituts”, ont pour mission de diffuser les savoir-faire, la culture et les meilleures pratiques au sein de l’organisation. On en comptait plus de 4 000 dans le monde, dont près de 100 en France en 2017. Les universités d’entreprise permettent de proposer des parcours sur mesure, alignés sur la stratégie de l’entreprise, et souvent d’économiser sur le long terme en internalisant une partie de la formation.
Plusieurs grands groupes français se sont dotés de telles structures. Veolia par exemple possède son “Campus Veolia”, un centre de formation interne qui forme chaque année plus de 200 000 employés à travers le monde, du technicien jusqu’au cadre dirigeant. Orange a son université d’entreprise “Orange Campus” dédiée au développement managérial et aux compétences numériques de ses collaborateurs. SNCF a créé une Université du Service pour former ses agents aux métiers de la relation client, tandis que TotalEnergies (ex-Total) et Air France disposent également de leurs propres académies internes. Ces exemples illustrent que les entreprises, surtout de grande taille, investissent directement dans la formation de leurs équipes, via des programmes internes ambitieux. L’objectif est double : s’assurer que les compétences clés sont maîtrisées en interne et adapter en permanence les savoir-faire aux évolutions du marché.
Les universités d’entreprise contribuent aussi à fédérer les collaborateurs autour de la culture d’entreprise et des mêmes standards professionnels. Elles renforcent le sentiment d’appartenance et peuvent servir d’outil d’attraction et de rétention des talents. Bien sûr, toutes les entreprises n’ont pas la taille critique pour créer leur propre université. Cependant, même sans structure formelle, toute entreprise peut encourager le partage de connaissances en interne (mentorat, tutorat, communautés de pratiques) et organiser des formations “maison” pour diffuser l’expertise de ses salariés les plus expérimentés. Il est également possible de mutualiser des centres de formation entre plusieurs entreprises partenaires ou d’ouvrir certaines sessions de l’université d’une entreprise à des fournisseurs, clients, etc., afin de rentabiliser l’infrastructure.
Quelles autres aides mobilisables pour les entreprises ?
En plus du CPF, d’autres dispositifs publics soutiennent les efforts des entreprises en matière de formation, en particulier dans des contextes spécifiques :
- Le FNE-Formation : historiquement Fonds National de l’Emploi dédié à la formation, le FNE-Formation a été largement mobilisé pendant la crise du Covid-19 pour financer la formation des salariés en activité partielle. En 2025, ce dispositif se poursuit « dans la continuité » avec une enveloppe budgétaire maintenue à 100 millions d’euros. Il cible notamment les entreprises confrontées à des difficultés conjoncturelles ou des mutations (transition écologique, numérique, etc.) et prend en charge une partie du coût pédagogique des formations. Le FNE peut ainsi aider les entreprises à former leurs salariés sans puiser entièrement dans leur budget, surtout en temps de crise ou de reconversion.
- Les aides des OPCO et de l’État : les opérateurs de compétences (OPCO) gèrent les fonds mutualisés et proposent des financements ou cofinancements de formations, principalement au bénéfice des TPE-PME. Par exemple, un OPCO peut financer tout ou partie d’une formation inscrite au plan de développement des compétences d’une petite entreprise, tant que celle-ci cotise et que la formation s’inscrit dans les critères définis (priorités de branche, coût horaire plafonné, etc.). De même, des financements régionaux ou nationaux ponctuels (plan d’investissement dans les compétences – PIC, plan de relance, etc.) peuvent être mobilisés sur des projets spécifiques (formation des demandeurs d’emploi, des jeunes, ou sur des thématiques prioritaires comme le numérique ou l’écologie). Ces appels à projets ou subventions ponctuelles requièrent souvent du montage de dossier, mais peuvent soulager le budget formation de l’entreprise en couvrant une partie des dépenses.
- L’alternance et les contrats aidés : employer un alternant (apprenti ou contrat de professionnalisation) représente un investissement en temps et en encadrement, mais il est largement soutenu financièrement par l’État. Les formations en alternance des jeunes sont très bien prises en charge via les opérateurs de compétences et France Compétences, ce qui explique qu’elles absorbent la majorité des fonds de formation. De plus, les entreprises bénéficient de primes à l’embauche d’apprentis et d’exonérations de cotisations sous certaines conditions. Former un jeune en alternance permet ainsi de répondre aux besoins futurs en compétences, avec un coût salarial et pédagogique allégé par ces aides publiques. C’est une forme de co-investissement État-entreprise particulièrement efficace pour former la prochaine génération de salariés selon les besoins réels du terrain.

Retrouvez notre webinaire avec nos experts partenaires
Quatre leviers pour optimiser le budget formation de l’entreprise
Face à la multitude de dispositifs et à la nécessité d’investir dans les compétences, les entreprises – en particulier les plus grandes qui disposent de moins d’aides relatives – ont tout intérêt à optimiser leur budget formation. Au-delà du choix des financements externes, bien gérer son plan de formation en interne permet de faire plus avec des ressources limitées. Voici quatre stratégies complémentaires pour améliorer le retour sur investissement des actions de formation :
- Négocier les volumes avec les organismes de formation : plutôt que d’acheter des formations au coup par coup pour chaque salarié, une entreprise a intérêt à regrouper des besoins et planifier des sessions en volume. En réservant, par exemple, 10 places sur une session au lieu d’une seule, on peut souvent obtenir un tarif unitaire plus avantageux auprès de l’organisme de formation. Cette négociation par volume est d’autant plus pertinente pour les structures multi-sites ou comprenant plusieurs filiales, qui sans cela multiplieraient les petits achats de formation de manière dispersée. Grouper les actions de formation permet aussi d’harmoniser le contenu suivi par différents salariés et de s’assurer que tous acquièrent un socle commun de compétences. À noter que dans le cadre du CPF, lorsqu’une entreprise crée un catalogue interne de formations éligibles, elle peut négocier en amont avec les prestataires les coûts et modalités, maximisant ainsi l’impact de chaque euro dépensé.
- Mutualiser les projets de formation : dans la même optique que la négociation de volumes, il s’agit de regrouper plusieurs projets de formation pour faire des économies d’échelle. Concrètement, cela peut signifier organiser une seule action de formation commune pour plusieurs services, plusieurs sites, voire plusieurs entreprises partenaires ayant des besoins similaires. En évitant de dupliquer les sessions pour chaque entité, on augmente le nombre de participants par session et on réduit le coût moyen par apprenant. Cette mutualisation peut aussi passer par le choix d’un prestataire unique capable de couvrir différents sujets de formation, plutôt que de solliciter une multitude d’organismes spécialisés. Moins de prestataires à gérer, ce sont potentiellement des rabais commerciaux pour volume global et une logistique simplifiée.
- Favoriser les formations “intra” (en interne) : “faire de l’intra” signifie organiser des formations en interne à l’entreprise, rassemblant uniquement ses propres salariés (par opposition à envoyer les collaborateurs sur des stages inter-entreprises avec d’autres clients). Dès qu’un certain nombre de salariés ont le même besoin, il devient plus rentable de faire venir le formateur dans l’entreprise (ou de mobiliser un formateur interne) et de former tout le monde ensemble. Par exemple, si 15 employés doivent être formés à un même logiciel, il est souvent moins coûteux de planifier une session dédiée dans vos locaux pour ces 15 personnes, que de payer 15 inscriptions séparées sur des sessions externes. L’intra permet aussi de contextualiser le contenu à l’activité de l’entreprise et de programmer la formation au moment opportun (éviter les périodes de pic d’activité, etc.). En groupant ainsi les collaborateurs en cohortes, on évite l’éparpillement des formations individuelles et on crée une dynamique d’équipe autour de l’apprentissage. Il en résulte non seulement des économies (tarif forfaitaire de groupe au lieu de tarifs unitaires), mais également une meilleure cohérence dans les compétences acquises par chacun.
- Digitaliser les formations autant que possible : le e-learning et les formations digitalisées offrent un potentiel important de réduction des coûts. En ayant recours à des modules en ligne, à des classes virtuelles ou à du blended learning (mixte présentiel/distanciel), on peut former davantage de personnes avec des moyens réduits. La digitalisation permet en effet d’annihiler la plupart des coûts logistiques liés à la formation présentielle : plus de déplacements, plus de frais de mission (transport, hôtels, repas) pour envoyer les salariés en stage. De plus, les plateformes e-learning offrent une grande flexibilité aux apprenants qui peuvent se former à leur rythme, tout en limitant l’impact sur le temps de travail. Certes, concevoir des contenus en ligne ou souscrire à des outils de formation digital a un coût initial, mais celui-ci est très vite amorti dès lors qu’on l’utilise à grande échelle. Par ailleurs, les contenus digitaux peuvent souvent être réutilisés plusieurs fois. Enfin – et ce point est crucial – les formations en ligne bien conçues permettent d’individualiser les parcours (adaptation au niveau de chacun, modules optionnels…) et de maintenir un meilleur engagement des apprenants, ce qui in fine augmente l’efficacité et le retour sur investissement de la formation. En résumé, former en digital revient à former plus, mieux, et moins cher lorsque cela s’y prête.
En combinant ces quatre leviers – négociation des coûts, mutualisation des actions, recours à l’intra et digitalisation – une entreprise peut substantiellement optimiser son budget formation sans sacrifier la qualité. Ces stratégies demandent bien sûr une bonne coordination interne (pour planifier et regrouper les besoins) et une vision globale des compétences à développer, mais les gains financiers et organisationnels sont au rendez-vous.

Vers un financement partenarial de la formation
Le financement de la formation professionnelle en France est un effort partagé entre l’individu, l’entreprise et la puissance publique. Dans le contexte actuel, l’accent est mis sur la responsabilisation de chacun : l’individu est maître de son CPF, l’État concentre ses financements sur des axes prioritaires (alternance, transitions écologique et numérique, etc.), et les entreprises sont encouragées à investir toujours plus dans les compétences de leurs salariés. Pour les employeurs, cela signifie adopter une approche proactive et stratégique. Il ne s’agit plus seulement de s’acquitter d’une taxe ou de répondre à des obligations administratives, mais bien de considérer la formation comme un investissement à part entière, avec des retours attendus en productivité, en innovation et en attractivité des talents.
Heureusement, des outils existent pour accompagner cet investissement : le CPF co-construit offre un moyen de cofinancer les projets professionnels des collaborateurs en alignement avec l’entreprise, les universités d’entreprise et les plans de formation internes permettent de façonner des programmes sur mesure; et des aides comme le FNE ou les financements OPCO soutiennent certains projets stratégiques ou conjoncturels. Mais au-delà des dispositifs, c’est la démarche globale qui compte. Les entreprises qui réussissent en la matière sont celles qui intègrent le développement des compétences dans leur vision à long terme, qui nouent un partenariat avec leurs salariés autour de la formation, et qui optimisent chaque euro dépensé pour en maximiser l’impact.
En définitive, financer la formation professionnelle n’est plus une simple question de coûts à subir, c’est devenu un levier à piloter. Dans un monde économique en rapide évolution, où les métiers et les technologies changent sans cesse, investir dans les compétences est sans doute l’une des meilleures assurances pour l’avenir. Et si le chemin du financement peut sembler complexe, il existe aujourd’hui suffisamment de repères et de bonnes pratiques pour que chaque entreprise, petite ou grande, trouve sa voie dans le labyrinthe de la formation et en ressorte gagnante – aux bénéfices de l’organisation comme des individus qui la composent.

